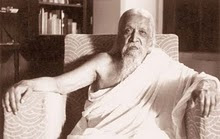D’abord, elle courut au bois de roses. Là, dans la dernière lueur du crépuscule, elle fouilla les massifs, elle cueillit toutes les roses qui s’alanguissaient (...). Elle les cueillait à terre, sans se soucier des épines ; elle les cueillait devant elle, des deux mains ; elle les cueillait au-dessus d’elle, se haussant sur les pieds, ployant les arbustes. Une telle hâte la poussait, qu’elle cassait les branches, elle qui avait le respect des moindres brins d’herbe. Bientôt elle eut des roses plein les bras, un fardeau de roses sous lequel elle chancelait. Puis, elle rentra au pavillon, ayant dépouillé le bois, emportant jusqu’aux pétales tombés ; et quand elle eut laissé glisser sa charge de roses sur le carreau de la chambre au plafond bleu, elle redescendit dans le parterre.
Alors, elle chercha les violettes. Elle en faisait des bouquets énormes qu’elle serrait un à un contre sa poitrine. Ensuite, elle chercha les œillets, coupant tout jusqu’aux boutons, liant des gerbes géantes d’œillets blancs, pareilles à des jattes de lait, des gerbes géantes d’œillets rouges, pareilles à des jattes de sang. Et elle chercha encore les quarantaines, les belles-de-nuit, les héliotropes, les lis ; elle prenait à poignée les dernières tiges épanouies des quarantaines, dont elle froissait sans pitié les ruches de satin ; elle dévastait les corbeilles de belles-de-nuit, ouvertes à peine à l’air du soir ; elle fauchait le champ des héliotropes, ramassant en tas sa moisson de fleurs ; elle mettait sous ses bras des paquets de lis, comme des paquets de roseaux. Lorsqu’elle fut de nouveau chargée, elle remonta au pavillon jeter, à côté des roses, les violettes, les œillets, les quarantaines, les belles-de-nuit, les héliotropes, les lis. Et, sans reprendre haleine, elle redescendit.
Cette fois, elle se rendit à ce coin mélancolique qui était comme le cimetière du parterre (...). Elle s’acharna surtout sur des plates-bandes de tubéreuses et de jacinthes, à genoux au milieu des herbes, menant sa récolte avec des précautions d’avare. Les tubéreuses semblaient pour elle des fleurs précieuses, qui devaient distiller goutte à goutte de l’or, des richesses, des biens extraordinaires. Les jacinthes, toutes perlées de leurs grains fleuris, étaient comme des colliers dont chaque perle allait lui verser des joies ignorées aux hommes. Et, bien qu’elle disparût dans la brassée de jacinthes et de tubéreuses qu’elle avait coupée, elle ravagea plus loin un champ de pavots, elle trouva moyen de raser encore un champ de soucis. Par-dessus les tubéreuses, par-dessus les jacinthes, les soucis et les pavots s’entassèrent. Elle revint en courant se décharger dans la chambre au plafond bleu, veillant à ce que le vent ne lui volât pas un pistil. Elle redescendit.
Qu’allait-elle cueillir maintenant ? Elle avait moissonné le parterre entier. Quand elle se haussait sur les pieds, elle ne voyait plus, sous l’ombre encore grise, que le parterre mort, n’ayant plus les yeux tendres de ses roses, le rire rouge de ses œillets, les cheveux parfumés de ses héliotropes. Pourtant, elle ne pouvait remonter les bras vides. Et elle s’attaqua aux herbes, aux verdures ; elle rampa, la poitrine contre le sol, cherchant dans une suprême étreinte de passion à emporter la terre elle-même. Ce fut la moisson des plantes odorantes, les citronnelles, les menthes, les verveines, dont elle emplissait sa jupe. Elle rencontra une bordure de baume et n’en laissa pas une feuille. Elle prit même deux grands fenouils, qu’elle jeta sur ses épaules, ainsi que deux arbres. Si elle avait pu, entre ses dents serrées, elle aurait emmené derrière elle toute la nappe verte du parterre. Puis, au seuil du pavillon, elle se tourna, elle jeta un dernier regard sur le Paradou. Il était noir ; la nuit, tombée complètement, lui avait jeté un drap noir sur la face. Et elle monta, pour ne plus redescendre.
Un extrait des merveilleuses descriptions de jardins dans La Faute de l'Abbé Mouret, de Emile Zola, 1875
En illustration : une photo du Jardin de Giverny (fera bientôt l'objet d'un article...bien sûr !).